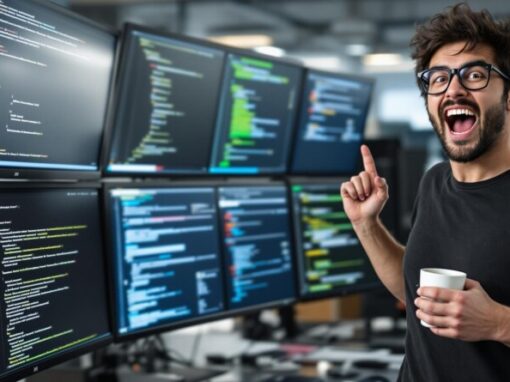Alors que les entreprises cherchent à améliorer les compétences linguistiques de leurs collaborateurs, l’intelligence artificielle (IA) s’impose peu à peu dans les dispositifs de formation. Rencontre avec George Wilson, Directeur des programmes d’anglais et de l’éducation scolaire du British Council, pour décrypter l’apport réel de l’IA dans l’apprentissage des langues.

[Interview]
La rédaction d’ORSYS : Depuis quand et pourquoi le British Council s’intéresse-t-il à l’IA ?
George Wilson : Le British Council existe depuis plus de 90 ans, avec pour mission phare l’enseignement de l’anglais. Pour maintenir notre position de leader, il est essentiel d’anticiper les évolutions à venir. L’organisme s’intéresse depuis longtemps aux technologies éducatives, et l’IA n’en est que la dernière itération — une étape supplémentaire dans un parcours d’innovation… Il est essentiel non seulement de comprendre mais aussi de façonner les outils d’IA afin qu’ils deviennent efficaces et non des disrupteurs négatifs de l’apprentissage des langues. En 2024, nous avons publié un rapport sur l’utilisation de l’IA dans l’enseignement de l’anglais, actualisé en juillet de la même année pour refléter les avancées les plus récentes. Nous souhaitons parler d’IA de façon informée et utile, pour en faire un levier de qualité dans nos pratiques.
L’IA peut-elle personnaliser l’apprentissage linguistique de façon efficace ?
La promesse de personnalisation offerte par l’IA suscite beaucoup d’attentes. Le mot « personnaliser » contient le mot « personne ». Or, cette personnalisation n’est pas nouvelle : les enseignants la pratiquent depuis toujours. Ce qui change, c’est que l’IA permet de l’automatiser et de l’affiner à grande échelle. Mais l’IA reste un outil. Elle ne remplace ni l’enseignant, ni l’échange humain. Elle peut contribuer à l’efficacité de la formation, comme Internet l’a fait en son temps.
L’acculturation à l’IA passe donc par la formation des enseignants. Il va falloir les accompagner afin qu’ils s’approprient les outils d’IA de la façon la plus efficace possible.
Cette transformation exige effectivement un accompagnement. Nous sommes tous concernés par l’acculturation à l’IA. Il ne s’agit pas seulement de maîtriser des outils, mais de réfléchir à leur usage dans nos pratiques professionnelles, dans une logique de responsabilité. Le British Council a publié des guides de bonnes pratiques pour accompagner les enseignants et les établissements dans cette transition. En France, cette dynamique est soutenue par une charte récente de l’Éducation nationale (juin 2025).
Quels types d’outils d’IA sont les plus prometteurs pour l’apprentissage de l’anglais ? Comment garantir que ces outils restent centrés sur l’humain et favorisent la progression réelle ?
L’IA générative et les grands modèles de langage (LLM) occupent aujourd’hui le devant de la scène. Ils peuvent bouleverser et influencer notre façon d’apprendre les langues, mais aussi remettre en question notre rapport à la communication en langue étrangère, tant leurs performances en traduction sont impressionnantes. Les outils de traduction automatique doivent toujours être utilisés avec discernement. Ils facilitent les échanges, mais ne remplacent ni l’expression personnelle, ni la compréhension culturelle. Le langage est une part de notre identité.
Pensez-vous que les compétences linguistiques deviendront moins importantes à l’ère des traducteurs automatiques ?
On peut tout à fait utiliser un traducteur pour aller plus vite, mais une conversation sincère, une relation de confiance ou d’amitié ne peuvent se nouer via une IA. Parler une langue, c’est aussi s’affirmer, faire des choix qui nous définissent. L’IA peut amplifier notre expression, mais elle ne doit pas se substituer à notre voix. Il est essentiel de garder le contrôle sur le message que l’on transmet.
Parlons bonnes pratiques et perspectives. Quels conseils donneriez-vous à une entreprise qui souhaite renforcer le niveau d’anglais de ses collaborateurs ?
Lorsqu’une entreprise souhaite améliorer le niveau d’anglais de ses collaborateurs, elle doit d’abord garder à l’esprit que chaque apprenant est unique. Trop souvent, les parcours de formation sont standardisés, reposant sur des niveaux de langue rigides, alors que chaque individu possède ses propres besoins linguistiques et professionnels. Il est donc crucial de faire appel à des experts capables d’évaluer ces besoins spécifiques et de concevoir des parcours véritablement personnalisés. Un PDG ne sollicite pas la langue anglaise de la même façon qu’un agent de sécurité : les usages diffèrent, les objectifs aussi.
Il convient également de sortir du mythe de la perfection linguistique. Ce qui importe, c’est la capacité à s’exprimer avec clarté et efficacité. Nombreux sont ceux que leur accent freine dans leur prise de parole, alors qu’il s’agit d’une richesse, d’un marqueur identitaire à préserver. Il faut cultiver la confiance, plus que l’obsession du sans-faute.
Enfin, il est essentiel de rappeler que l’enseignement de l’anglais ne s’improvise pas. Parler anglais ne suffit pas à être formateur. C’est un métier, qui s’appuie sur des connaissances solides en pédagogie, en linguistique, et sur une expérience construite. Choisir les bons professionnels, c’est garantir des formations de qualité.
Tous vos professeurs d’anglais ne sont donc pas forcément des natifs ?
Les meilleurs enseignants ne sont pas forcément natifs. Ce qui compte, c’est la maîtrise de la langue et la compétence à l’enseigner. Il faut dépasser cette idée que l’origine détermine la légitimité. La diversité des parcours et des expériences enrichit l’apprentissage.
Comment imaginez-vous l’évolution de la formation linguistique dans les cinq prochaines années ?
Nous menons actuellement plusieurs projets de recherche dans le cadre de notre étude, The Future of English. Cette étude explore huit grandes thématiques, parmi lesquelles : dans quelle mesure les besoins professionnels vont-ils redéfinir les modalités d’apprentissage ? Les réponses ne sont pas encore arrêtées, mais une chose est certaine pour moi : l’avenir de la formation linguistique doit s’appuyer sur des principes solides.
Il faut sortir d’une vision centrée exclusivement sur les locuteurs natifs. L’anglais appartient à tous ceux qui l’utilisent, et aujourd’hui, ils sont plus nombreux à le parler comme langue secondaire que comme langue maternelle. C’est cette réalité qu’il faut renforcer : la confiance, l’appropriation, l’usage du quotidien — qu’il soit professionnel, affectif ou académique.
La technologie jouera un rôle central dans cette transformation. Elle ouvre déjà des perspectives nouvelles, en donnant accès à des formats hybrides ou à distance plus souples et plus inclusifs. On l’a vu depuis la pandémie : l’enseignement en ligne a bouleversé les pratiques, sans éliminer le besoin de présentiel. Ce nouvel équilibre permet de mieux adapter les outils pédagogiques à chaque situation. Il ouvre aussi la voie à une approche plus inclusive, où les langues maternelles et le multilinguisme ont toute leur place en salle de formation, loin de l’idée que seule la langue cible devrait s’y exprimer.
En apprendre plus sur le travail du British Council pour accompagner l’enseignement, l’apprentissage et l’évaluation de l’anglais en France : https://www.britishcouncil.fr/en/programmes/english-programmes/education